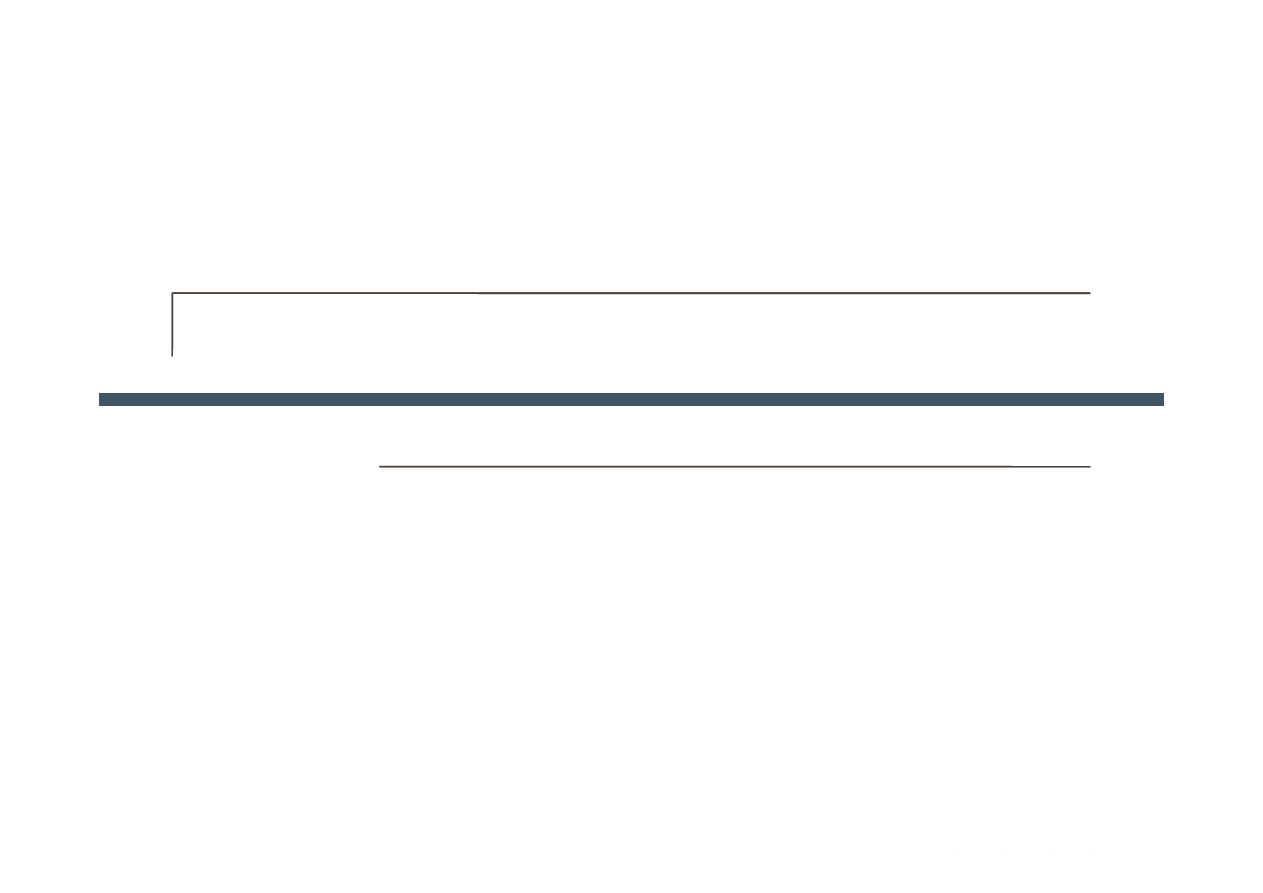
Questions de méthode et éléments normatifs
Fixer le montant des prestations de compensation du handicap :
Agnès Gramain
Professeur en sciences économiques
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
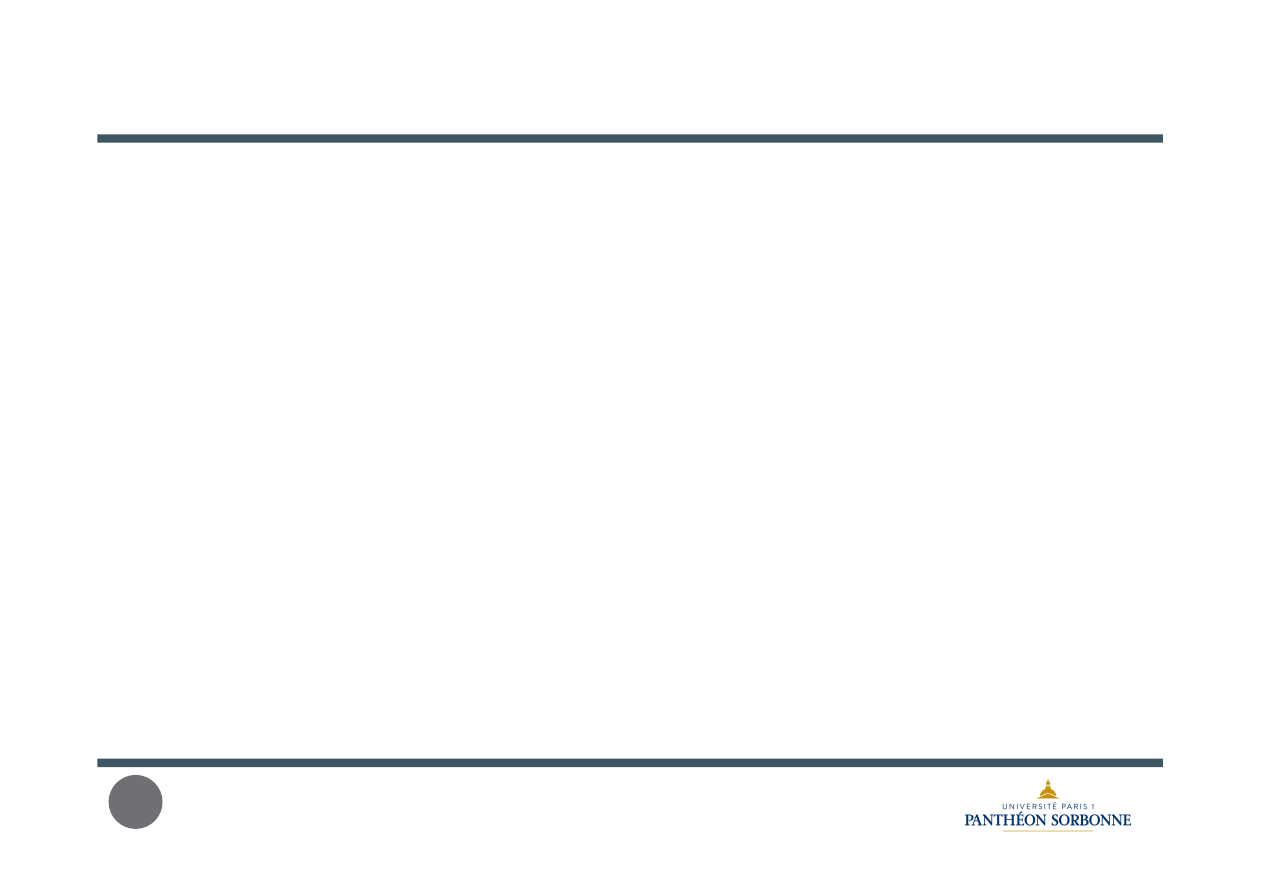
Préambule
3 modes de mobilisation de la solidarité collective
°
Politiques d’accessibilité (prévention tertiaire)
°
Revenus de remplacements
°
Financement des sur-couts (PCH/APA)
Définition juridique de la compensation du handicap
« La personne handicapée a droit à la compensation des
conséquences de
son handicap
quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge
ou son mode de vie. Cette compensation consiste à
répondre à ses besoins
…
Les
besoins
de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en
considération des
besoins
et des
aspirations
de la personne handicapée tels
qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-
même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle
ne peut exprimer son avis. » CASF Article L114-1-1
Journée « Espaces, qualité de vie et situations de handicaps », MESHS - Lille (21 avril 2016)
2
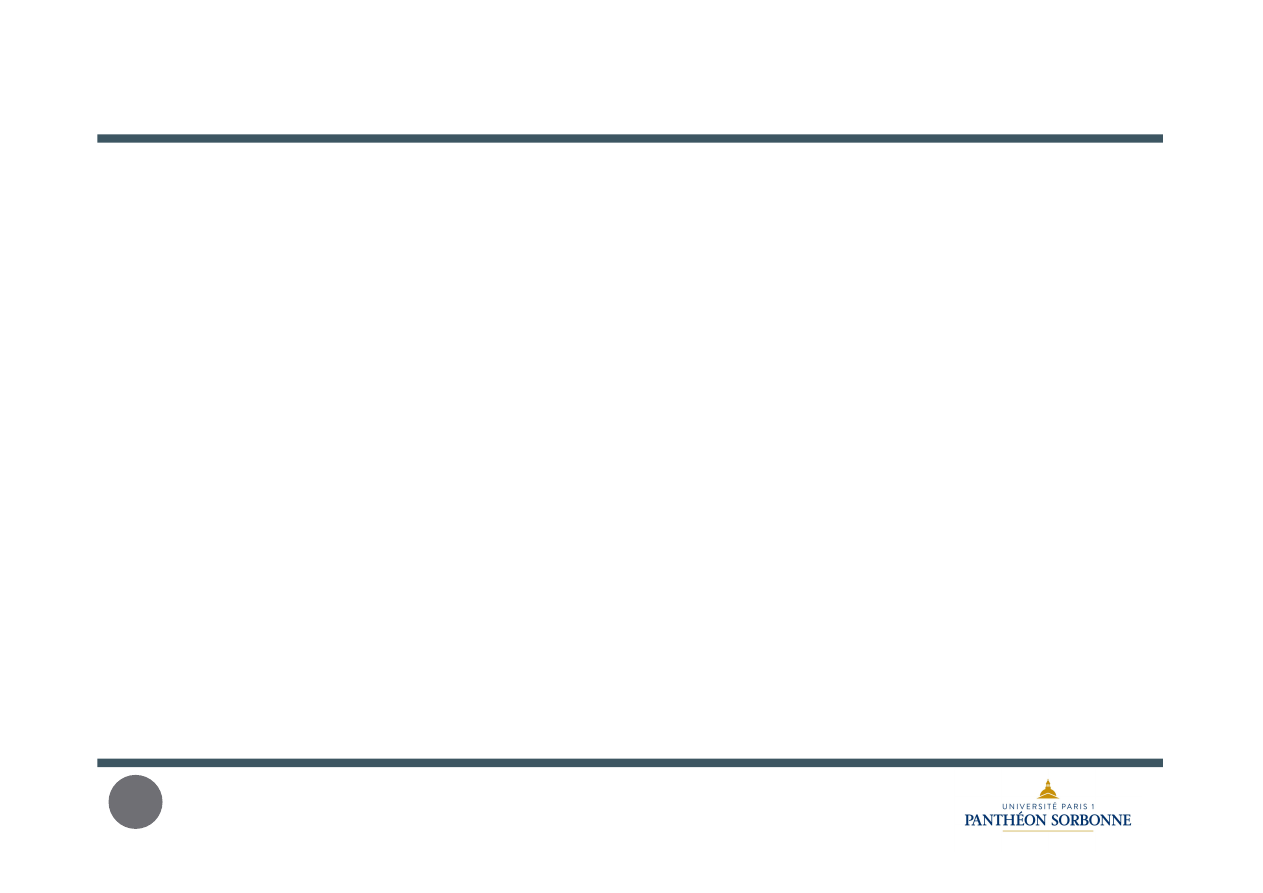
Préambule
Au cœur du financement public de la compensation du handicap
°
Place pour la subjectivité des personnes (« aspirations »)
°
Place pour la norme sociale (« besoins »)
°
Quelle articulation des deux ?
Se décline en trois questions distinctes
°
Comment passe-t-on des aspirations à des besoins personnalisés ?
°
Comment choisit-on la nature de la réponse aux besoins ?
°
Comment choisit-on le montant du financement de la réponse ?
La manière de réfléchir diffère selon la forme de prestation (nature/espèce)
°
en nature -> définition a priori d’un panier de B&S légitimes
°
en espèce -> la norme sociale ne porte que sur le niveau d’aide
°
Le cadre d’analyse des économistes correspond mieux à la logique des
prestations en espèce
Journée « Espaces, qualité de vie et situations de handicaps », MESHS - Lille (21 avril 2016)
3
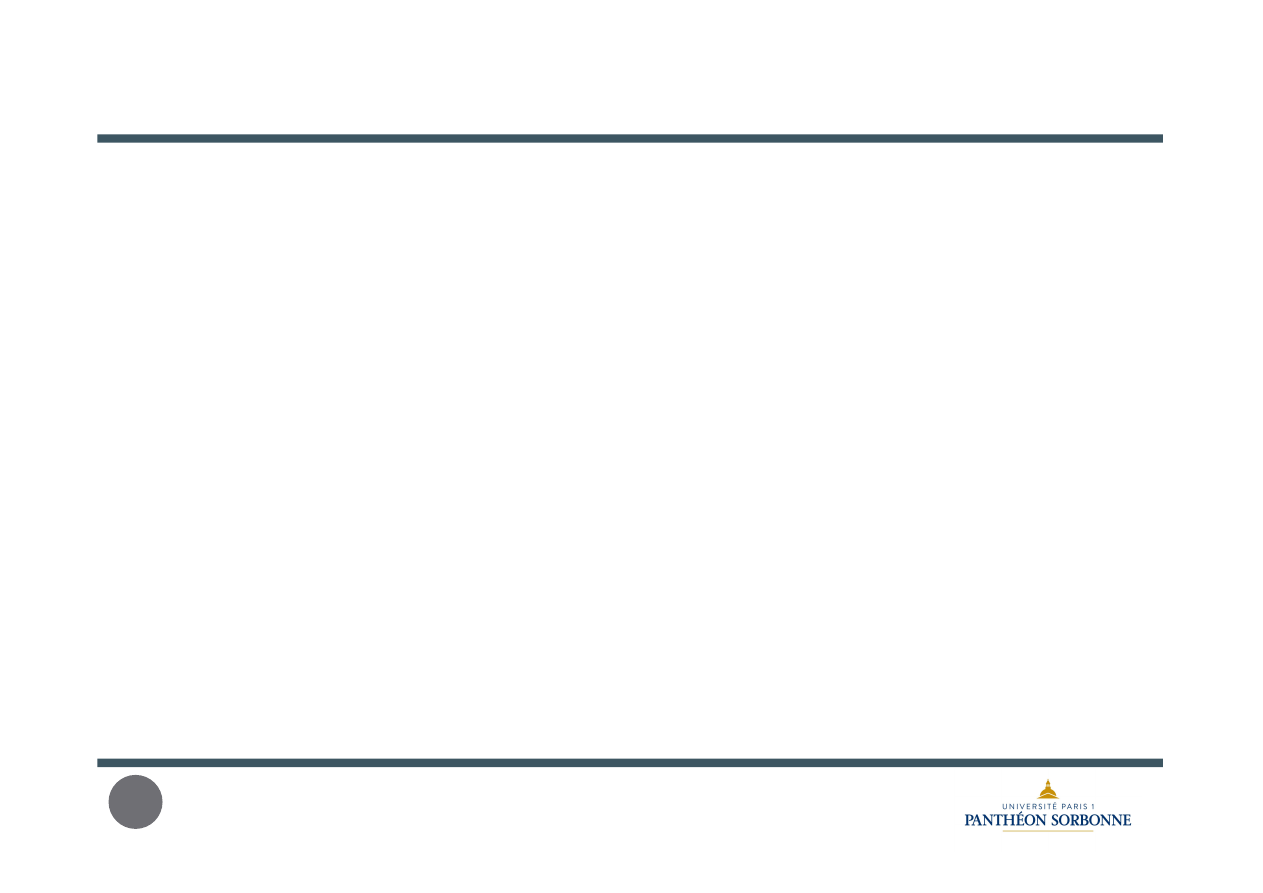
Cadre analytique des études économiques
Quelques mots en « isme »
°
Conséquentialisme : seules les conséquences des actions comptent
°
Welfarisme : seules les conséquences sur le bien-être des individus comptent
°
Subjectivisme : la définition du bien-être est propre à chaque individu
°
les conséquences du handicap = les
différences de bien-être subjectif
induites
par le handicap
Une « compensation » à fixer en deux temps
°
1
er
temps : valoriser le différentiel de bien-être subjectif subi
°
Pose des questions de méthodes
°
2
ème
temps : fixer la part prise en charge par la solidarité collective
°
Pose des questions normatives
Journée « Espaces, qualité de vie et situations de handicaps », MESHS - Lille (21 avril 2016)
4
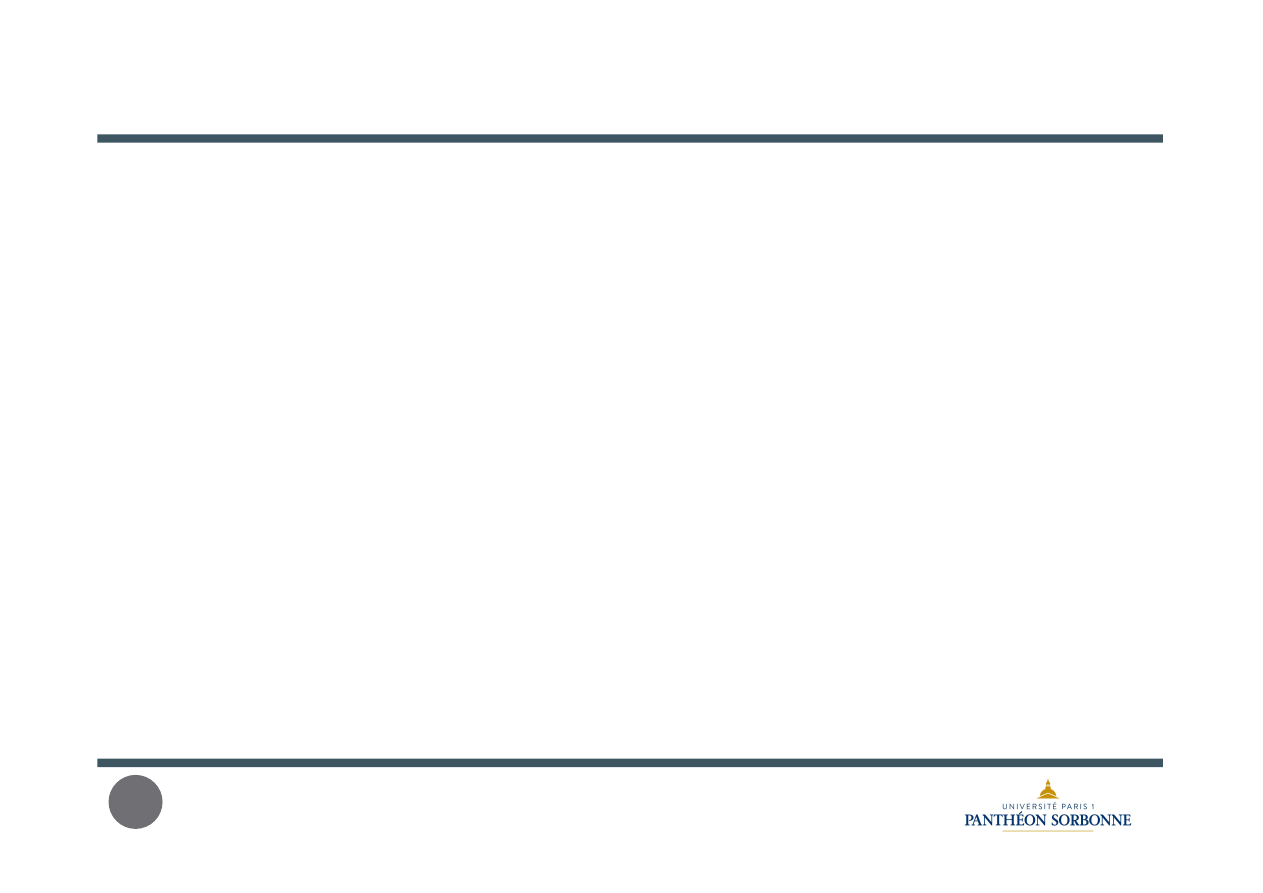
Cadre normatif
Deux conceptions classiques de la justice sociale pour guider l’action
publique
°
Critère utilitariste : maximiser la somme des bien-être individuels
°
Critère égalitariste : maximiser le bien-être du plus mal loti
Quelles implications pour la compensation du handicap ?
°
Critère utilitariste conduit à des conclusions éthiquement inacceptables
°
La prévalence du handicap est faible
°
Amélioration du bien-être couteuse
°
Les politiques de compensation du handicap s’ancrent dans une conception
égalitariste de la justice sociale
°
Critère égalitariste suppose de quantifier les différentiels de bien-être
°
Des personnes en situation de handicap avec et sans compensation
°
Des personnes en situation de handicap avec celles sans handicap
Journée « Espaces, qualité de vie et situations de handicaps », MESHS - Lille (21 avril 2016)
5
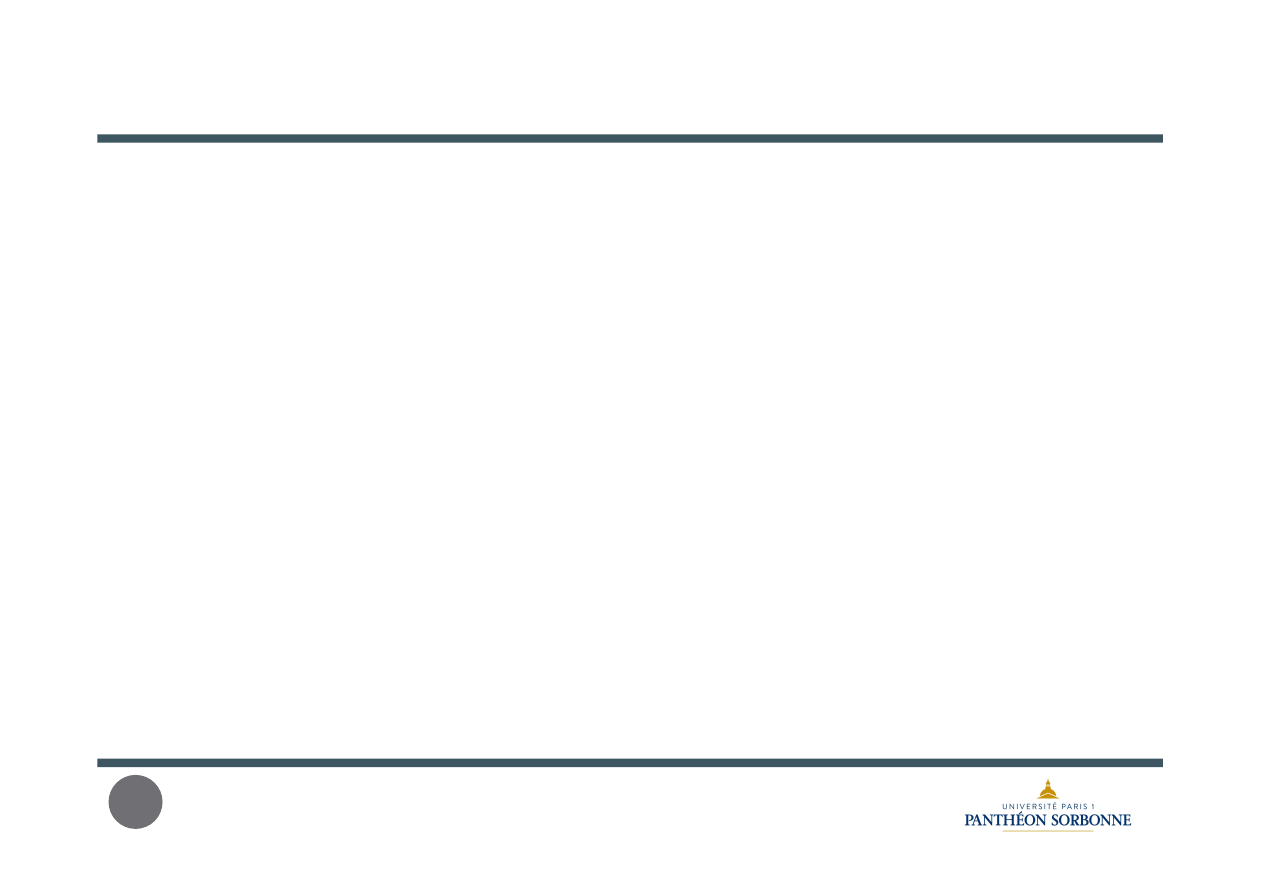
Quelles méthodes de mesure ?
Un même modèle de comportement
°
L’individu utilise au mieux ses ressources pour maximiser son bien-être
°
Ressources budgétaires financent des achats spécifiques et des achats non
spécifiques
°
1
ère
idée : mesure « directe » par
la valeur des achats spécifiques
Pb : suppose de déterminer ce qui est spécifique et ne donne qu’une borne inférieure
°
2
ème
idée : mesure « indirecte » par
les ressources supplémentaires
nécessaires
pour garantir à un individu donné l’accès au niveau de bien-être
qu’il aurait sans handicap
Pb : mesurer et comparer les niveaux de bien-être
Journée « Espaces, qualité de vie et situations de handicaps », MESHS - Lille (21 avril 2016)
6
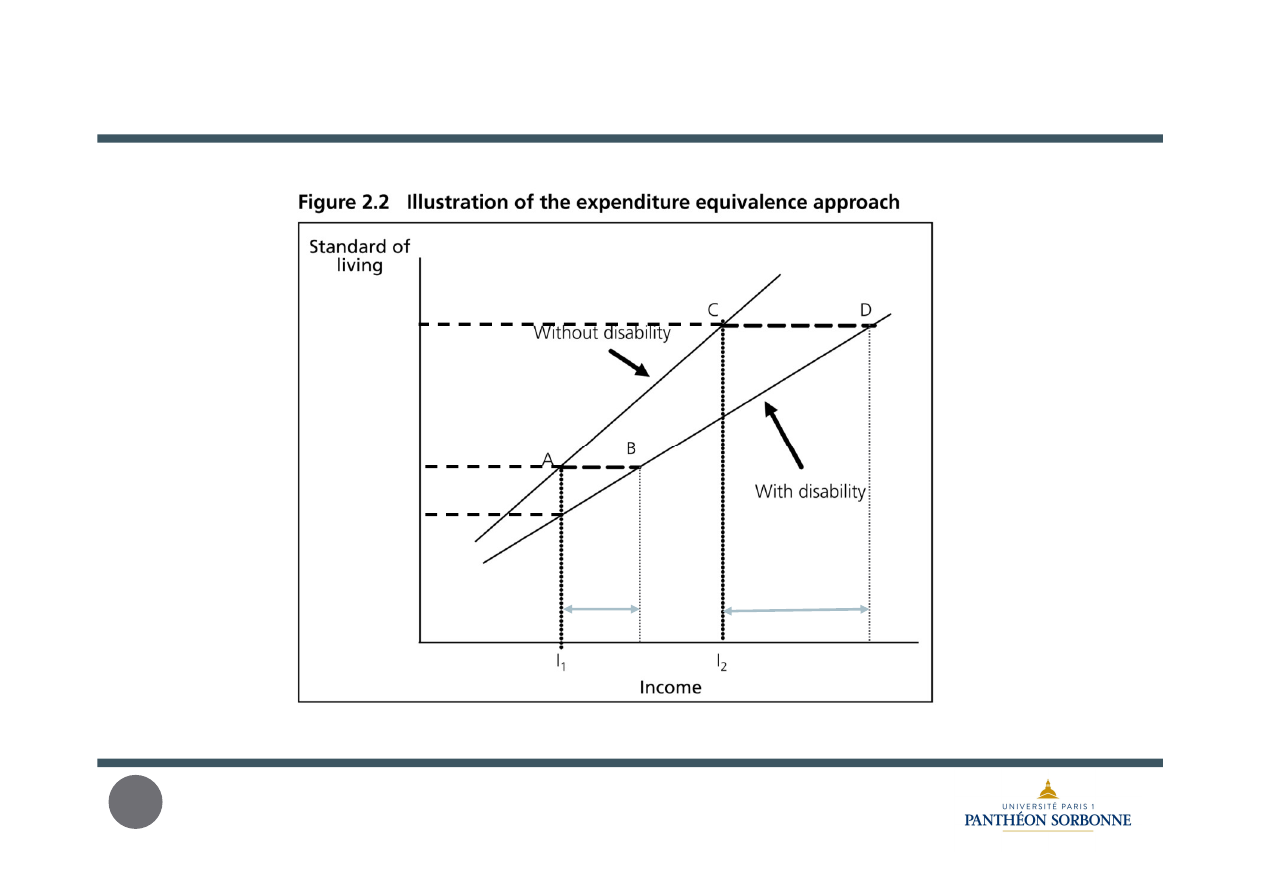
2
ème
idée : mesure indirecte
Journée « Espaces, qualité de vie et situations de handicaps », MESHS - Lille (21 avril 2016)
7
S
1
AH
S
1
SH
S
2
SH

Les deux principales méthodes utilisées
1.
Evaluation subjective du revenu nécessaire pour atteindre le BE actuel,
sans handicap
(ou l’inverse)
°
Principe sous-jacents
°
A bien-être donné, le différentiel de revenu capture les coûts induits par le handicap
°
Hypothèses sous-jacentes
°
Un individu est capable d’imaginer ce que seraient ses besoins non-satisfaits si il était
en situation de handicap (ou l’inverse)
°
Un individu est capable d’estimer le revenu nécessaire pour y répondre
Question : Dans quels cas peut-on faire confiance à cet exercice de pensée?
2.
Comparaison des revenus à équipement des ménages identique
°
Principe sous-jacents
°
A bien-être donné, le différentiel de revenu capture les coûts induits par le handicap
°
Hypothèses sous-jacentes
°
L’équipement des ménages capture le niveau de bien-être (entorse à la subjectivité)
°
Le lien entre équipement et bien-être est le même, en moyenne, que l’on soit ou non
en situation de handicap.
Question : Dans quels cas peut-on faire une telle hypothèse de comparabilité ?
Journée « Espaces, qualité de vie et situations de handicaps », MESHS - Lille (21 avril 2016)
8
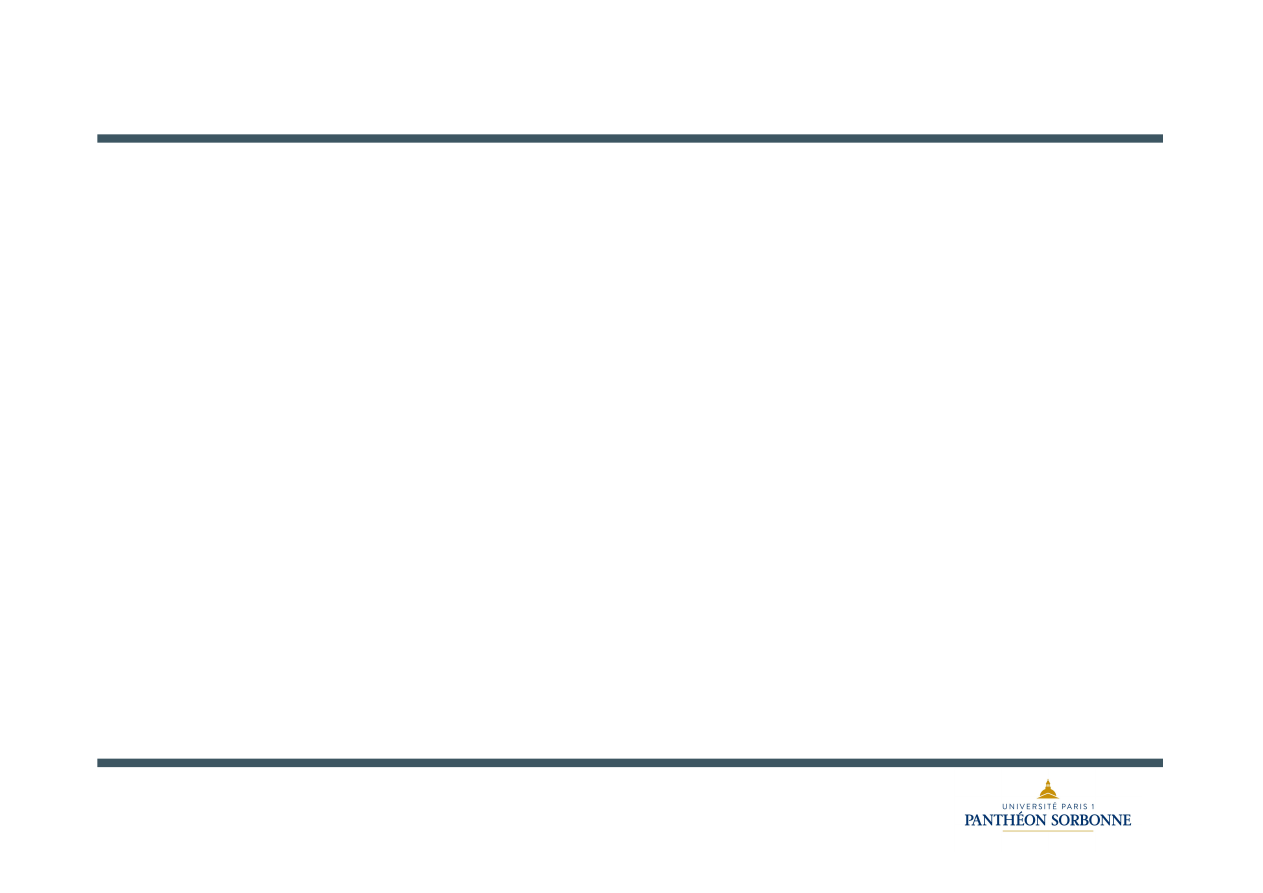
D’autres pistes en guise de conclusion
°
Fragilité des méthodes usuelles
°
Exercice de la pensée acrobatique
°
Indicateur discutable de la qualité de vie
°
Hypothèse de comparabilité des sources de bien-être entre différentes
situations
°
Améliorer ces méthodes grâce à d’autres sciences humaines et sociales
°
Mieux comprendre les déterminants objectifs de la qualité de vie
°
Mieux repérer les sources d’hétérogénéité entre les individus
°
Suggestion de méthode alternative
observer le comportement des aidants
°
Indicateur indirect de la qualité de vie des personnes aidées
°
Comparable avec celui de personnes sans handicap